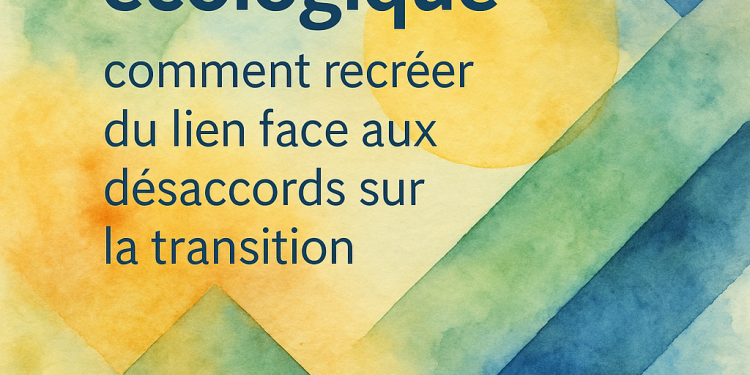Faut-il encore dialoguer ?
À l’heure où les alertes climatiques se multiplient, les tensions autour des solutions à adopter semblent, elles aussi, s’intensifier. Face à l’urgence, nombreux sont ceux qui veulent convaincre, accélérer, transformer. Mais ce désir de changement se heurte à des résistances multiples : climato-scepticisme, fatigue militante, repli identitaire, ou encore confiance aveugle dans les technologies. Dans ce contexte, le dialogue semble à la fois plus nécessaire que jamais… et plus difficile que jamais.
C’est précisément cette question que nous avons explorée collectivement lors d’un atelier forum ouvert auquel j’ai eu le plaisir de participer, aux côtés de citoyen·nes, professionnel·les, artistes, militant·es et chercheur·ses, à l’occasion des Rencontres Univershiftées. Animé par Camille Grandet et Thomas Verdine, ce moment a permis à près de 60 personnes de réfléchir ensemble à la possibilité du dialogue dans un monde traversé par l’incertitude, les désaccords et les urgences multiples. Chaque groupe de réflexion à produit une synthèse des discussions et des questions sous-jacentes traitées autours de la thématique principale :
Climato-septiques, écolos-radicaux, techno-solutionistes… comment favoriser le dialogue pour un avenir commun !


Comment retisser du lien face à des visions opposées ? Comment maintenir des espaces de discussion ouverts, sincères, puissants — même (et surtout) quand les clivages sont profonds ? Quelles postures, quels outils, quelles conditions permettent de rendre le dialogue à nouveau fertile, transformateur, réparateur ?
Cet article propose une synthèse de cette expérience collective, en essayant d’y retranscrire et d’y organiser la connaissance collective produite : réflexions philosophiques, typologies de postures, retours d’expérience concrets, et outils d’animation innovants. Avec cette matière, nous allons tenter de répondre à cette question : faut-il encore dialoguer ? Et si oui, comment faire ?
1. Redéfinir le dialogue écologique : au-delà du débat
Le vrai sens du dialogue : écouter sans convaincre
On confond souvent dialogue et débat. Le débat oppose, cherche à convaincre. Le dialogue, lui, cherche à comprendre, à tisser du lien, à faire émerger des pistes nouvelles. Comme l’ont souligné plusieurs participants lors des discussions, dialoguer c’est avant tout écouter sans chercher à avoir raison.
Cela suppose une posture d’humilité active : faire preuve d’intérêt sincère pour l’autre, poser des questions, sortir de ses certitudes. Cela passe par un travail sur soi : apprendre à parler en « je », à exprimer ses émotions, à reformuler sans projeter. C’est toute une éducation à l’écoute qui est en jeu — bien plus difficile que d’argumenter.
L’une des clés évoquées réside dans la capacité à suspendre temporairement son besoin d’avoir raison. Dans un monde saturé d’opinions et de prises de parole, offrir une écoute désintéressée est devenu un acte radical.
Les limites du dialogue dans la transition
Mais dialoguer ne signifie pas tout accepter. Plusieurs intervenant·es ont mis en garde contre une forme de naïveté : tout n’est pas dialoguable. Il existe des rapports de force, des postures figées, des refus explicites d’entrer dans une conversation de bonne foi.
Certains sujets — trop techniques, trop spirituels, ou trop polarisés — ne permettent pas toujours une mise en commun immédiate. Le techno-solutionnisme, par exemple, peut parfois fonctionner comme une croyance fermée, empêchant l’ouverture à d’autres visions du monde. D’autres fois, ce sont les asymétries de pouvoir ou d’expertise qui rendent le dialogue déséquilibré, voire manipulatoire.
Dans ces cas, il peut être nécessaire d’assumer une stratégie de confrontation ou de retrait temporaire. Cela ne veut pas dire renoncer au dialogue, mais choisir avec discernement les conditions et les moments où il est fécond.
Le dialogue comme transformation mutuelle
Enfin, dialoguer ne vise pas à « faire changer d’avis » l’autre, mais à se laisser transformer mutuellement. Dans un monde qui change, aucun individu ne détient la totalité de la vérité. C’est dans la rencontre entre points de vue, émotions, expériences vécues, que peut émerger une compréhension élargie.
Cela implique un double mouvement :
- Reconnaître l’autre comme légitime, même dans ses doutes ou ses peurs ;
- Accepter d’être soi-même déplacé, sans y voir une faiblesse, mais un apprentissage.
Autrement dit, le dialogue véritable est une forme d’écologie des relations humaines, où l’on cultive la confiance, l’attention et la complexité.
2. Comprendre les postures pour mieux dialoguer
Si dialoguer, c’est aller à la rencontre de l’autre, encore faut-il comprendre d’où l’autre parle. Que cherche-t-il à défendre ? De quoi a-t-il peur ? Que refuse-t-il de perdre ? Derrière chaque désaccord se cache un mécanisme de protection, une émotion, une histoire. Comprendre les postures n’est pas un luxe théorique : c’est une condition pour sortir de l’affrontement stérile.
Typologie : sceptiques, rassuristes, défaitistes…
Lors de l’atelier, une typologie a été proposée (notamment par Jacques) pour mieux nommer et situer certaines postures fréquemment rencontrées :
- Le sceptique : il doute, souvent de bonne foi, mais manque de repères fiables.
- Le négationniste : il rejette la réalité climatique par intérêt (économique, politique, identitaire).
- Le relativiste : il minimise l’enjeu en s’abritant derrière des chiffres (“la France ne représente que 1%…”).
- Le défaitiste : convaincu de la catastrophe, il ne voit plus de solution et se replie.
- Le rassuriste : il se réfugie dans une confiance absolue envers les technologies, sans remise en question.
Cette grille de lecture permet de sortir du réflexe « pour ou contre ». Elle invite à une approche stratégique du dialogue : à quel type de posture ai-je affaire ? Cela vaut-il la peine d’engager l’échange ? Si oui, avec quels mots, sur quels terrains ?
Derrière les postures, des émotions
Ce qui fait tenir une posture n’est pas toujours un raisonnement logique. Plus souvent, ce sont des émotions, des expériences passées ou des peurs. La colère, l’impuissance, la culpabilité, le désespoir peuvent tour à tour alimenter le climato-scepticisme, le techno-solutionnisme ou le repli.
Plusieurs groupes ont évoqué la nécessité d’identifier les moteurs profonds de chaque posture :
- La peur du changement (perte de repères, d’emploi, d’identité).
- L’effet de groupe (ne pas vouloir être en dissonance avec son entourage).
- Le désespoir (perte de sens, crise existentielle face à l’ampleur des enjeux).
Une posture n’est pas une personne
Un point crucial : il ne s’agit pas d’étiqueter les individus, mais de distinguer leurs postures du moment. Une même personne peut, selon le contexte, être rassuriste, puis défaitiste, puis engagée. Nous oscillons tous entre plusieurs récits selon notre fatigue, nos ressources, ou les espaces que nous habitons.
Reconnaître cela, c’est s’ouvrir à une écologie des postures : plutôt que de vouloir convaincre ou “corriger”, on peut chercher à comprendre ce que cette posture protège… et comment proposer un chemin d’évolution.
3. Sortir du débat stérile : activer la transformation douce
Une fois les postures identifiées, une question se pose : comment engager un échange fertile sans tomber dans l’affrontement ni dans l’évitement ? Le dialogue n’est pas une bataille d’arguments, c’est un terrain de transformation. Plusieurs groupes ont proposé d’abandonner la logique gagnant/perdant pour expérimenter une autre approche : le cheminement commun.
Passer du face-à-face au côte-à-côte
Changer le cadre, c’est déjà changer la conversation. Dans un débat frontal, chacun campe sur ses positions. Mais lorsqu’on se place à côté de l’autre, sur un territoire partagé (une histoire, un lieu, une expérience), le lien se crée autrement.
Ronan, lors des échanges, a souligné l’importance de l’exemple personnel, de la transmission par l’expérience. Montrer ce que l’on vit, ce que l’on gagne à changer, peut ouvrir une brèche là où les arguments échouent. Le désir de transformation devient alors contagieux, non conflictuel.
Semer plutôt que convaincre
Plusieurs participant·es ont rappelé une évidence qu’on oublie parfois : on ne fait pas changer quelqu’un contre son gré. Chercher à convaincre à tout prix, c’est risquer de bloquer la relation. À l’inverse, semer une idée, un doute, une image, peut produire ses effets bien après la discussion.
Il s’agit donc d’accepter l’incomplétude du dialogue. Ce que l’on cherche, ce n’est pas une victoire, mais un déplacement — parfois minuscule, parfois invisible, mais réel.
S’appuyer sur les arts, les récits, le jeu
Et si le dialogue ne passait pas (seulement) par les mots ? Plusieurs groupes ont proposé des moyens créatifs et décalés de provoquer la réflexion :
- Les arts vivants (théâtre, danse, musique) créent des émotions partagées, ouvrent l’imaginaire, permettent d’incarner d’autres points de vue sans jugement. Caroline et son groupe ont exploré cette piste comme levier de coopération dans le groupe.
- L’humour et le stand-up permettent de parler de sujets sensibles avec légèreté, en désactivant les résistances.
- Les jeux vidéo peuvent devenir des espaces de rencontre pour des publics peu touchés par les canaux classiques de sensibilisation. Marceau et son groupe ont évoqué l’idée de jeux narratifs ou de communautés en ligne comme terrains d’activation indirecte.
Ces approches ne remplacent pas le dialogue rationnel, mais elles en changent le climat. Elles permettent de réinstaller la curiosité, désamorcer les peurs, et créer un langage commun par le vécu.
4. Créer les bonnes conditions du dialogue écologique
Le dialogue ne dépend pas uniquement de la volonté des individus. Il est profondément influencé par le lieu, le cadre, les règles du jeu, et les dynamiques sociales en présence. Si l’on veut qu’un échange soit constructif, il faut en soigner l’écosystème.
Où dialoguer ? Espaces publics, lieux mixtes
« Où rencontrer des personnes qui pensent autrement, sans que ça tourne au clash ? » — C’est la question posée par Cécile et son groupe. Leur réponse : hors des bulles.
Nous avons tendance à nous entourer de personnes qui nous ressemblent, qui valident nos idées, qui partagent nos références. Or, pour dialoguer véritablement, il faut aller là où la diversité des visions est possible : dans les lieux publics, les espaces partagés, les moments de vie quotidienne.
Quelques exemples évoqués :
- Un banc, une file d’attente, un trajet en train.
- Une médiathèque, un centre social, un marché.
- Un cadre administratif ou institutionnel, où les profils sont plus variés.
Ces espaces, souvent banals, sont des laboratoires de conversation potentiels — à condition qu’ils soient habités avec conscience.
Un cadre protecteur et inclusif
Dialoguer en profondeur suppose un minimum de sécurité psychologique. Cela signifie : pouvoir parler sans être jugé, pouvoir écouter sans se sentir menacé, pouvoir douter sans être exclu. C’est pourquoi certains formats inspirants ont été cités :
- Les conventions citoyennes, où le cadre est structuré, équilibré et légitime.
- Les cercles de parole ou groupes de co-développement, où chacun prend la parole à tour de rôle, avec des règles claires.
- Les ateliers participatifs, basés sur l’intelligence collective, où les émotions et les désaccords peuvent cohabiter sans escalade.
Le cadre n’est pas une contrainte : c’est un levier. Il crée les conditions de la confiance, et donc de l’échange.
Diversité des voix et mixité des récits
Enfin, pour que le dialogue ne tourne pas à l’entre-soi, il faut veiller à la diversité : des âges, des parcours, des croyances, des récits de vie.
Cela suppose une posture d’inclusion active :
- Inviter des personnes absentes des cercles habituels.
- Créer des passerelles entre les mondes : élus, jeunes, anciens, travailleurs, soignants, chercheurs, croyants…
- Accepter l’inconfort du désaccord comme une richesse, non une menace.
Le dialogue fertile est celui qui accepte la complexité du réel, et qui l’honore à travers la pluralité des voix.
5. Sciences, récits et émotions : les piliers d’un dialogue fertile
Dans les discussions sur la transition écologique, une question revient souvent : faut-il “convaincre par les faits” ? Peut-on encore faire appel à la science face à des croyances, des émotions, ou des discours complotistes ? Et quel rôle jouent les récits — personnels ou collectifs — dans ce processus de transformation ?
Faire confiance à la science tout en reconnaissant ses limites
Anna et son groupe ont abordé une question sensible : “Pourquoi faire confiance aux scientifiques, s’ils se sont déjà trompés ?” Derrière cette interrogation se cache une crise de confiance plus large envers les institutions, les experts, les discours d’autorité.
Pour y répondre, plusieurs pistes ont été évoquées :
- Expliquer que la science n’est pas vérité absolue, mais méthode : elle avance par essais, erreurs, remises en question.
- Raconter l’histoire de la méthode scientifique : ses doutes, ses débats, ses controverses.
- Souligner qu’un consensus scientifique fort (comme celui sur le climat) est précisément ce qui rend la position crédible.
- Refuser de confondre science et communication médiatique : beaucoup de “remises en cause” viennent de simplifications ou de raccourcis médiatiques, pas du travail scientifique lui-même.
Autrement dit, il faut à la fois défendre la rigueur scientifique, et reconnaître ses limites — pour ne pas tomber dans l’arrogance ou le déni de complexité.
Les faits ne suffisent plus : place à l’émotion
Une autre leçon forte est revenue dans plusieurs groupes : les faits seuls ne suffisent pas. Montrer un graphique, citer une étude, ne transforme pas nécessairement un interlocuteur. Parfois même, cela le renforce dans sa posture de rejet, par un phénomène bien connu de dissonance cognitive.
C’est pourquoi l’émotion, l’imaginaire, le récit personnel sont devenus essentiels. Ils permettent d’ancrer une information dans une histoire vécue, de la rendre sensible et signifiante. On n’agit pas parce qu’on a compris — on agit parce qu’on a été touché.
Plusieurs participants ont ainsi plaidé pour :
- Partager des récits d’engagements réussis.
- Valoriser les bénéfices immédiats de l’action écologique (santé, qualité de vie, relations humaines).
- S’appuyer sur les récits culturels déjà présents (mythes, contes, séries, jeux vidéo) pour faire passer des messages.
Pour une écologie des récits
Enfin, une idée transversale émerge : le changement passe aussi par une transformation de nos récits collectifs.
Aujourd’hui, beaucoup restent enfermés dans des récits d’effondrement, de guerre, ou d’impuissance. Pour redonner envie d’agir, il faut raconter d’autres histoires :
- Des histoires de coopération, de renouveau, de réparation.
- Des utopies concrètes, ancrées dans le réel, désirables et accessibles.
- Des “petites victoires” locales qui changent tout.
Ce travail sur les récits est un travail politique, culturel, émotionnel. Il est complémentaire du savoir scientifique, et tout aussi nécessaire.
6. Savoir quand dialoguer… et quand renoncer
Dialoguer n’est pas toujours la bonne option. Ce constat, loin d’invalider l’importance du lien, nous pousse à réfléchir à l’usage stratégique de notre énergie.
Évaluer le rapport énergie / impact
Une idée forte portée par Jacques et son groupe : tout dialogue a un coût. Il mobilise du temps, de l’attention, parfois une grande charge émotionnelle. Or, dans certains cas, cette énergie est inutilement dépensée : lorsque l’interlocuteur est fermé, agressif, ou simplement imperméable.
D’où la proposition d’un outil simple d’aide à la décision :

Sur un axe horizontal, l’énergie que cela vous demande.
Sur un axe vertical, l’impact potentiel de la discussion.
Ce type de grille permet de faire un choix éclairé : vaut-il mieux poursuivre, changer de canal, ou se retirer ? Ne pas dialoguer n’est pas toujours une fuite — cela peut être un acte de lucidité.
Le temps long des prises de conscience
Dans de nombreux témoignages, on retrouve une idée fondamentale : le dialogue porte ses fruits dans le temps. Il ne faut pas tout attendre d’un échange unique. Parfois, une phrase entendue aujourd’hui fera effet six mois plus tard, dans un autre contexte, au détour d’un événement personnel.
Accepter cela, c’est sortir de la logique de résultat immédiat. C’est reconnaître que le dialogue est un processus, pas un verdict.
Choisir ses combats, ses cercles, ses moments
En fin de compte, la question n’est pas faut-il dialoguer ou non, mais : où, avec qui, et dans quelles conditions ?
- Avec des proches ? Peut-être. Mais cela dépend de l’état de la relation.
- Avec des inconnus ? Souvent plus simple, paradoxalement.
- Avec des collectifs déjà engagés ? Très utile, pour maintenir une culture du désaccord constructif.
Le véritable enjeu n’est pas de dialoguer avec tout le monde, tout le temps. C’est de créer des espaces où le dialogue est possible, sincère, et fécond.
Conclusion : le dialogue écologique comme art du lien
Ce qui ressort de ces échanges, ce n’est pas une recette miracle pour convaincre ou rallier. C’est une invitation à changer de posture : moins convaincre, plus relier ; moins débattre, plus écouter ; moins juger, plus comprendre.
Le dialogue véritable n’est ni naïf, ni tiède. Il est exigeant. Il suppose de la clarté sur ses limites, du soin dans sa mise en œuvre, et une attention constante à l’humain derrière l’idée.
Dans un monde où les fractures idéologiques, sociales et culturelles se creusent, dialoguer devient un acte politique radical. Il s’agit de retisser ce qui a été rompu, d’explorer ensemble les marges d’accord, de transformer le désaccord en terrain fertile.
Car si le dialogue ne suffit pas à faire basculer le monde, il est sans doute le sol sur lequel toute transition juste peut pousser.