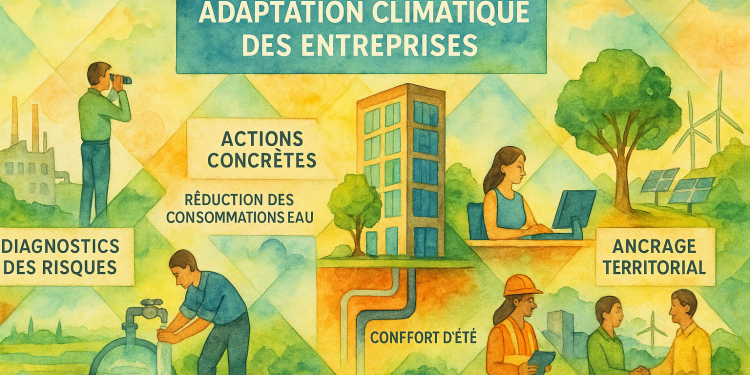Face à l’accélération des risques climatiques, l’adaptation climatique devient une priorité stratégique pour les entreprises. Comment anticiper les impacts du dérèglement climatique sur vos activités ? Par où commencer ? À travers 30 retours d’expérience d’entreprises françaises, le guide de l’ADEME offre des pistes concrètes pour construire un parcours d’adaptation efficace : diagnostic des risques, plan d’action, suivi, ancrage territorial… Dans cet article, découvrez pourquoi et comment intégrer l’adaptation climatique à votre stratégie d’entreprise, quels en sont les déclencheurs, les bénéfices mesurables, et les leviers collectifs à activer pour faire de cette transformation une opportunité.
Intoduction
L’accélération du changement climatique n’est plus une hypothèse : c’est une réalité tangible dont les effets bouleversent déjà les équilibres naturels, les territoires… et les modèles économiques. Canicules, sécheresses, inondations, incendies ou tensions sur la ressource en eau : les entreprises françaises, tous secteurs confondus, font face à des perturbations croissantes.
Si la réduction des émissions de gaz à effet de serre est aujourd’hui bien identifiée, l’autre pilier de l’action climatique reste encore trop peu mobilisé : l’adaptation climatique. Pourtant, selon le rapport 2023 du World Economic Forum, les trois principaux risques mondiaux de la décennie sont liés au climat. Pour les entreprises, anticiper ces risques devient un impératif de continuité, de compétitivité et de résilience.
Face à cette urgence, l’ADEME, en partenariat avec le Ministère de la Transition écologique et l’association Entreprises pour l’Environnement (EpE), a publié un guide précieux : une sélection de 30 témoignages d’entreprises françaises engagées dans des démarches concrètes d’adaptation climatique. Ces retours d’expérience permettent de dépasser les approches théoriques, en montrant que des réponses existent, qu’elles soient techniques, organisationnelles ou fondées sur la nature.
Ce blog vous propose une synthèse structurée de ce guide, pour comprendre pourquoi et comment engager votre entreprise dans un parcours d’adaptation climatique, quels en sont les leviers, les actions possibles, les obstacles fréquents, et les bénéfices attendus. Car l’adaptation n’est pas une option, c’est une stratégie d’avenir.
Pourquoi l’adaptation devient vitale pour les entreprises
L’adaptation climatique est désormais un enjeu stratégique incontournable pour les entreprises. Au-delà des engagements en matière de décarbonation, il s’agit de faire face aux conséquences déjà visibles du dérèglement climatique : perturbations des chaînes logistiques, tensions sur les ressources, vulnérabilité des infrastructures, impact sur la santé et la productivité des salariés.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. En 2022, les événements climatiques extrêmes ont généré 264 milliards de dollars de pertes économiques à l’échelle mondiale (source : Lancet Countdown, 2023). En France, les incendies en Gironde ont désorganisé toute la filière bois et réduit la fréquentation touristique de 40 % dans le Bassin d’Arcachon. En Allemagne, les sécheresses ayant affecté le niveau du Rhin ont coûté 250 millions d’euros à un seul industriel en raison de l’impact sur la logistique et la production.
Les canicules sont également devenues un risque majeur. Elles ont entraîné la perte de 490 milliards d’heures de travail potentielles en 2022, soit 143 heures en moyenne par travailleur dans le monde, selon les données du Lancet. Dans les secteurs les plus exposés, les investissements dans la protection des salariés se révèlent largement rentables, grâce à la réduction du turnover et des arrêts maladie.
Les petites et moyennes entreprises (PME/TPE) sont particulièrement exposées. Moins couvertes par l’assurance, avec des marges de manœuvre financières plus réduites, elles ont plus de difficultés à se relever après un choc climatique. L’exemple d’un constructeur de dépanneuses contraint à la liquidation après un épisode de grêle, faute d’indemnisation suffisante, illustre la brutalité de ces situations.
C’est pourquoi anticiper les risques, par une démarche d’adaptation climatique structurée, est vital. Les entreprises ayant mis en place un plan de continuité d’activité ou des mécanismes de couverture du risque (assurances, réserves) sont statistiquement bien plus résilientes en cas de crise. L’adaptation permet de renforcer la robustesse opérationnelle tout en créant des avantages concurrentiels durables.
Face à l’intensification des aléas et à l’incertitude croissante, ne pas intégrer l’adaptation climatique dans sa stratégie revient à exposer son entreprise à des pertes majeures. À l’inverse, agir aujourd’hui, c’est construire la pérennité de demain.
Qu’est-ce qu’un parcours d’adaptation ?
L’adaptation climatique ne se résume pas à des actions ponctuelles en réaction à une crise. Elle s’inscrit dans une logique de transformation stratégique et d’anticipation à long terme. Pour guider les entreprises, l’ADEME définit deux types de parcours : le parcours d’adaptation partiel et le parcours d’adaptation complet.

Le parcours d’adaptation partiel
Ce parcours est souvent initié en réaction à un événement climatique marquant (canicule, inondation, sécheresse…). Il se traduit par la mise en œuvre d’actions isolées visant à limiter les perturbations immédiates : adaptation d’un bâtiment, changement d’organisation du travail, sécurisation d’un approvisionnement.
S’il représente un premier pas concret vers la résilience, le parcours partiel reste limité par son périmètre restreint. Il ne permet pas une vision d’ensemble des vulnérabilités ni une transformation durable du modèle d’affaires. Toutefois, il facilite la montée en compétence des équipes et peut amorcer une dynamique plus large.
Le parcours d’adaptation complet
Le parcours complet est structuré en trois phases clés :
- Diagnostic : évaluation des risques et opportunités liés au changement climatique sur l’ensemble de l’entreprise. Cela inclut l’analyse des menaces physiques, mais aussi des dépendances critiques (eau, énergie, chaîne de valeur, ressources humaines…).
- Stratégie : planification des actions à moyen et long terme, articulation avec les ressources disponibles, intégration dans les choix d’investissement, révision des priorités opérationnelles.
- Suivi et évaluation : mesure de l’efficacité des actions menées, ajustement des priorités, pilotage de la transformation dans une logique d’amélioration continue.
Ce type de parcours permet une adaptation climatique cohérente et alignée avec les autres objectifs de l’entreprise (décarbonation, innovation, RSE…). Il mobilise l’ensemble des parties prenantes internes et s’ancre dans les dynamiques territoriales et sectorielles.
Un enjeu collectif : penser l’adaptation dans l’écosystème
Les entreprises ne sont pas isolées. Leurs chaînes de valeur, leurs partenaires, leurs territoires sont également confrontés aux impacts climatiques. C’est pourquoi le guide insiste sur l’importance de coopérer avec les acteurs des filières et des territoires : collectivités, agences de l’eau, fédérations professionnelles, partenaires industriels…
Cette approche systémique renforce l’efficacité des mesures, crée des co-bénéfices et favorise l’émergence de projets mutualisés (partage d’infrastructures, mutualisation des risques, innovation collective…).
Ainsi, un parcours d’adaptation climatique ne se limite pas à une série de mesures techniques. C’est une démarche stratégique de transformation qui s’inscrit dans la durée, en lien avec les mutations de l’environnement, du marché et des attentes sociétales.
Déclencheurs : qu’est-ce qui pousse à agir ?
Pourquoi certaines entreprises prennent-elles les devants en matière d’adaptation climatique, tandis que d’autres restent attentistes ? Le guide ADEME identifie cinq grands types de déclencheurs, souvent combinés, qui marquent le point de départ d’un parcours d’adaptation.

1. L’expérience directe des risques climatiques
C’est de loin le déclencheur le plus fréquent. Lorsqu’une entreprise subit un événement extrême — sécheresse, inondation, canicule, tempête — les impacts sur ses salariés, ses équipements ou son chiffre d’affaires sont souvent suffisants pour faire naître une prise de conscience.
Exemple : chez Charles & Alice, un arrêté préfectoral limitant l’usage de l’eau en 2017 a révélé un risque critique de rupture d’activité. Cela a conduit à une réduction drastique de la consommation grâce à des technologies de rupture.
De même, Everest Isolation a adapté son organisation du travail dès 2003 après avoir constaté des impacts sanitaires sur ses salariés lors de fortes chaleurs.
2. La pression réglementaire
De plus en plus de textes législatifs intègrent l’adaptation climatique, que ce soit à l’échelle nationale (obligations sur l’eau, plans de rafraîchissement dans le secteur de la santé) ou européenne, avec la directive CSRD qui impose aux grandes entreprises de documenter leurs plans d’adaptation.
Certaines filières, comme la grande distribution via Perifem, participent même activement à l’élaboration de propositions réglementaires, favorisant une adaptation collective du secteur.
3. La demande des parties prenantes
Clients, collectivités, investisseurs et même salariés peuvent exercer une pression croissante pour que l’entreprise intègre les risques climatiques dans sa gestion. Dans le secteur immobilier, par exemple, Nexity observe que ses clients attendent des garanties sur la résilience des bâtiments face au climat futur.
Cette exigence est aussi portée par les marchés publics ou les chaînes de valeur, qui intègrent désormais des critères liés à la continuité d’activité ou à la gestion des ressources.
4. Une démarche systémique de gestion des risques
Pour certaines entreprises, c’est l’approfondissement d’une cartographie des risques ou d’un bilan carbone qui révèle la nécessité d’intégrer l’adaptation climatique.
Chez Michelin, la mise à jour de la cartographie environnementale a conduit à une évaluation fine des risques physiques liés au climat. À Jas Hennessy, l’adaptation des vignobles s’est imposée comme une priorité après l’analyse de l’impact amont dans la chaîne de valeur.
5. Un prolongement naturel d’engagements RSE
Enfin, l’adaptation climatique peut émerger comme un co-bénéfice d’une démarche environnementale ou sociale déjà engagée. C’est le cas de Pocheco, où les mesures en faveur du bien-être au travail ont aussi permis d’optimiser les bâtiments face aux canicules.
Chez Barjane, c’est l’obtention de la certification ISO 14001 qui a incité à réaliser un diagnostic de vulnérabilité climatique intégré.
Quel que soit le déclencheur initial, l’engagement de la direction est systématiquement cité comme un facteur déterminant. Sans portage stratégique, il est difficile de mobiliser les équipes et d’ancrer l’adaptation climatique dans les priorités de l’entreprise.
Agir concrètement : quelles actions d’adaptation ?
L’un des messages forts du guide ADEME est que l’adaptation climatique est à la portée de toutes les entreprises, quels que soient leur secteur ou leur taille. Il ne s’agit pas uniquement de grands travaux ou d’investissements lourds, mais aussi d’actions organisationnelles, comportementales ou territoriales, souvent à effet immédiat.
Une grande diversité d’actions
Les retours d’expérience analysés dans le guide montrent la variété des leviers activables :
- Techniques : optimisation thermique des bâtiments, géothermie, dispositifs de récupération d’eau, revêtements perméables, végétalisation…
- Organisationnelles : aménagement des horaires, formation des équipes, gestion du stress thermique, adaptation des processus métiers.
- Fondées sur la nature (SafN) : restauration de zones humides, réouverture de bras de fleuves, végétalisation urbaine, infiltration naturelle des eaux pluviales…
Ces mesures sont parfois simples, mais produisent des résultats tangibles.
Exemples d’actions menées
- Charles & Alice : réduction de 70 % de la consommation d’eau entre 2003 et 2023, grâce à des réutilisations internes et à la mise en circuit fermé de systèmes de refroidissement.
- Clinique Saint-Roch : recours à la géothermie sur nappe pour le chauffage et le rafraîchissement, avec à la clé une réduction de 52 % des émissions de GES et un meilleur confort d’été sans climatisation.
- BIC : adaptation des sites de production pour mieux gérer les vagues de chaleur, en intégrant l’adaptation dès la conception architecturale.
- Auchan : installation de sous-compteurs communicants et parking perméable pour la gestion des eaux pluviales, dans le cadre d’un partenariat avec l’Agence de l’eau.
- CNR (Compagnie Nationale du Rhône) : mise en œuvre de SafN pour restaurer les écosystèmes alluviaux et prévenir les crues.
Des bénéfices concrets et mesurables
Au-delà de la résilience, les actions d’adaptation climatique permettent souvent :
- Une réduction des coûts d’exploitation (énergie, eau, maintenance).
- Une meilleure productivité grâce à un meilleur confort des collaborateurs.
- Une attractivité accrue en termes de marque employeur et de RSE.
- Un avantage compétitif, notamment sur les marchés soumis à des exigences climatiques croissantes.
Certaines entreprises ont même observé un retour sur investissement rapide, comme dans le cas de BIC où le surcoût initial a été absorbé en moins de 12 mois grâce aux économies d’énergie et aux Certificats d’Économie d’Énergie (CEE).
Une démarche progressive
Pour beaucoup d’entreprises, ces actions sont le fruit d’un apprentissage par l’expérimentation. Il est donc recommandé d’adopter une approche “pas à pas”, en testant des solutions à petite échelle avant de les déployer plus largement. Cela permet de lever les freins internes et de générer une dynamique d’engagement collectif.
Ainsi, l’adaptation climatique se traduit par des gestes concrets, mesurables, rentables, bien loin des idées reçues. La clé réside dans la capacité à articuler ces actions autour d’une vision stratégique à long terme, ce que nous aborderons dans la prochaine partie.
Clés de succès et obstacles à anticiper
S’engager dans une démarche d’adaptation climatique soulève à la fois des opportunités et des défis. Les témoignages analysés dans le guide ADEME permettent d’identifier les facteurs qui facilitent la réussite d’un parcours d’adaptation, mais aussi les difficultés fréquemment rencontrées par les entreprises.

Les facteurs de succès
1. Un pilotage stratégique fort
L’implication de la direction est citée comme une condition sine qua non. L’adaptation climatique engage des choix de moyen et long terme, souvent transversaux. Elle nécessite donc un portage clair et visible de la part du comité exécutif ou de la direction RSE.
2. L’implication des équipes
Faire remonter les besoins du terrain, impliquer les collaborateurs dans le diagnostic et les choix d’actions, permet non seulement une meilleure pertinence des solutions, mais aussi leur appropriation et leur pérennité. Cela renforce la cohésion interne.
3. Une approche progressive et pragmatique
Les démarches les plus efficaces commencent souvent par un projet pilote, une expérimentation ou une action concrète. Ce “pas à pas” facilite l’acculturation au sujet, la gestion du changement et la montée en compétence interne.
4. Une valorisation des bénéfices immédiats
Montrer que l’adaptation climatique génère des effets positifs visibles — réduction d’absentéisme, économies d’eau, confort thermique, résilience financière — permet de convaincre les parties prenantes internes, en particulier les fonctions opérationnelles.
5. La synergie avec d’autres enjeux RSE
L’adaptation peut venir renforcer d’autres démarches : santé au travail, biodiversité, économie circulaire, innovation, etc. Ce croisement des objectifs permet de mutualiser les ressources et de donner du sens à l’action.
6. L’appui des acteurs institutionnels
ADEME, agences de l’eau, chambres consulaires, collectivités territoriales : ces acteurs peuvent accompagner techniquement et financièrement les entreprises dans leurs diagnostics et investissements. Leur rôle est central pour favoriser un ancrage territorial cohérent.
Les difficultés rencontrées
1. Manque de maturité du sujet en entreprise
Contrairement à la réduction des émissions de GES, l’adaptation climatique reste un sujet peu structuré. Il existe peu de standards, peu de retours d’expérience partagés, et un déficit de référentiels opérationnels.
2. Complexité des diagnostics et de la stratégie
Analyser des scénarios climatiques, cartographier des risques physiques (y compris sur la chaîne de valeur), prioriser des actions en fonction de leur rentabilité ou de leur faisabilité technique peut nécessiter un accompagnement externe.
3. Déficit d’indicateurs financiers
Il est encore difficile d’évaluer précisément le “coût de l’inaction” ou le ROI d’une action d’adaptation. Cela freine l’intégration du climat dans les outils d’aide à la décision et les arbitrages d’investissement.
4. Décalage temporel entre les enjeux et les cycles opérationnels
Les scénarios climatiques se projettent sur 2050 ou 2100, alors que les décisions d’investissement se font sur 3 à 5 ans. Ce différentiel rend l’adaptation difficile à intégrer dans les logiques économiques actuelles.
5. Difficulté à mobiliser sans crise visible
Tant que les impacts climatiques restent abstraits ou irréguliers, il peut être difficile de justifier des mesures préventives. Le passage à l’action est souvent déclenché après une crise, et non avant.
Ces constats renforcent une conviction centrale du guide : l’adaptation climatique ne peut pas être improvisée. Elle doit être planifiée, outillée, partagée, et intégrée dans une démarche de transformation continue. Et pour cela, il est souvent utile de s’appuyer sur des coopérations élargies… ce que nous allons aborder dans la dernière partie.
Ancrer l’adaptation dans son territoire et sa filière
L’adaptation climatique ne peut être réduite à une stratégie strictement interne. Une entreprise évolue dans un écosystème : elle dépend de ressources locales, de partenaires économiques, de règles territoriales, d’infrastructures partagées. C’est pourquoi le guide ADEME insiste sur la nécessité de penser l’adaptation en interaction avec le territoire et la filière.
Pourquoi sortir du périmètre de l’entreprise ?
Les impacts climatiques — stress hydrique, canicules, risques d’inondation, dégradation des sols, tensions énergétiques — affectent souvent des zones entières, des bassins d’activité, des chaînes de valeur complètes. Agir seul, à l’échelle d’un site ou d’un processus, ne suffit pas à sécuriser durablement l’activité.
Exemple : en cas de pénurie d’eau, une entreprise agroalimentaire ne pourra pas continuer à produire si ses fournisseurs agricoles sont en rupture ou si les réseaux d’irrigation locaux sont coupés. De même, une entreprise industrielle située dans une vallée inondable dépend d’aménagements collectifs de gestion de l’eau.
Coopérer au sein des filières
Certaines filières commencent à structurer des démarches collectives d’adaptation climatique. C’est le cas de la grande distribution, qui, via l’association Perifem, a travaillé à mutualiser les réflexions sur la gestion de l’eau ou la résilience énergétique des magasins.
Dans le secteur du bâtiment ou de la santé, des dynamiques d’échange de bonnes pratiques, de normalisation et de co-développement émergent également.
Cette logique de coopération permet :
- De partager les coûts et les expertises.
- D’aligner les exigences entre donneurs d’ordres et sous-traitants.
- D’initier des projets communs à plus grande échelle.
Mobiliser les dynamiques territoriales
Les territoires sont souvent les premiers à se doter de plans d’adaptation (Plans Climat, Plans Eau, stratégies d’aménagement résilientes). S’y connecter permet de bénéficier d’un effet de levier important :
- Financements mobilisables (ADEME, Agences de l’eau, collectivités locales).
- Données climatiques locales accessibles (études, diagnostics).
- Projets de territoire avec co-bénéfices (restauration écologique, gestion de crise…).
Des exemples comme la Compagnie Nationale du Rhône montrent comment un acteur économique peut coopérer avec des collectivités, des institutions scientifiques et des agences de l’eau pour mettre en œuvre des Solutions d’Adaptation fondées sur la Nature (SafN) à l’échelle d’un fleuve entier.
Un enjeu de cohérence, de solidarité et d’efficacité
Penser l’adaptation climatique au-delà des murs de l’entreprise permet :
- De renforcer la cohérence des efforts (éviter les actions isolées et contradictoires).
- De développer des solidarités locales (entre acteurs économiques, publics et citoyens).
- De favoriser l’émergence de projets à impacts multiples, bénéfiques pour le climat, la biodiversité, la santé et l’économie.
En résumé, l’adaptation climatique ne doit pas être perçue comme un exercice solitaire. C’est un levier de transformation collective, un terrain de coopération fertile entre entreprises, filières et territoires. Pour aller plus loin, il s’agit désormais d’outiller cette coopération, de la financer, et de l’inscrire dans les politiques de résilience économique.
Résilience, Compétitivité et Responsabilité
L’adaptation climatique n’est plus une option secondaire réservée aux grandes entreprises industrielles ou aux collectivités. Elle devient un enjeu central de résilience, de compétitivité et de responsabilité pour toutes les organisations, quels que soient leur secteur, leur taille ou leur niveau de maturité environnementale.
Ce que montre le guide de l’ADEME à travers 30 retours d’expérience concrets, c’est que l’action est possible, pertinente et souvent rentable. Les entreprises qui anticipent aujourd’hui les risques climatiques seront mieux armées pour faire face aux crises de demain, tout en renforçant leur attractivité, leur performance opérationnelle et leur ancrage territorial.
Agir, c’est aussi rejoindre un mouvement collectif. Coopérer avec son territoire, engager sa filière, intégrer les attentes des clients, des partenaires et des régulateurs : autant de leviers pour faire de l’adaptation climatique un vecteur de transformation stratégique et non une simple réponse défensive.
Le moment est venu de passer de la prise de conscience à l’action structurée. Le parcours d’adaptation n’a pas besoin d’être parfait dès le départ. Mais il doit être engagé, soutenu par la direction, nourri par le terrain, articulé aux autres démarches RSE et outillé par les ressources disponibles.
Commencer aujourd’hui, c’est gagner du temps sur demain. L’ADEME, les agences de l’eau, les chambres consulaires, les dispositifs publics et les retours d’expérience partagés dans ce guide sont autant de ressources à mobiliser pour initier ou renforcer votre propre démarche.
L’adaptation climatique, ce n’est pas juste se protéger du climat qui change. C’est préparer son entreprise à réussir dans un monde en mutation.
Pour en savoir plus : En entreprise, comment s’engager dans un parcours d’adaptation au changement climatique ?