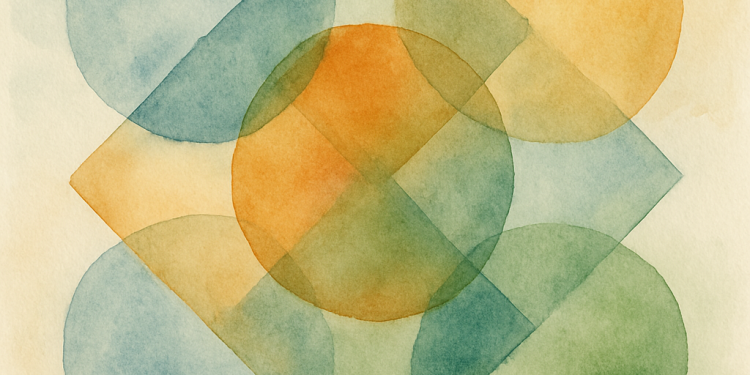Pourquoi l’adaptation climatique a besoin de se transformer
Face à l’accélération du dérèglement climatique, les efforts d’adaptation se multiplient. Plans canicule, solutions fondées sur la nature, innovations agricoles ou infrastructures de résilience se déploient dans de nombreux territoires. Pourtant, un constat s’impose : ces actions peinent à transformer en profondeur les systèmes sociaux, économiques et écologiques qu’elles prétendent protéger.
Trop souvent, les politiques d’adaptation se limitent à des ajustements techniques ou réglementaires à la marge. Elles traitent les symptômes plus que les causes, et ignorent les inégalités sociales ou la dégradation structurelle des écosystèmes. Ce décalage alimente une inquiétude croissante : sommes-nous réellement en train de nous adapter, ou seulement de temporiser ?
C’est dans ce contexte qu’un groupe de chercheurs néerlandais a entrepris une analyse rigoureuse de 51 projets d’adaptation aux Pays-Bas. Leur objectif : évaluer dans quelle mesure ces initiatives sont réellement “transformationnelle”. Autrement dit, dans quelle mesure elles changent les règles du jeu plutôt que de prolonger le statu quo.
Leur travail, publié en 2024 dans la revue Global Environmental Change, propose une lecture innovante de l’adaptation climatique. Plutôt que d’opposer adaptation « incrémentale » et adaptation « transformationnelle », ils introduisent une grille d’analyse à six dimensions, permettant de situer chaque action selon son niveau d’ambition et d’impact structurel.
Dans cet article, nous vous proposons une synthèse de cette approche, de ses enseignements et des implications concrètes pour les porteurs de projets, collectivités ou acteurs publics. Car repenser l’adaptation ne relève pas seulement de la théorie : c’est une nécessité stratégique si l’on veut bâtir une société résiliente, juste et soutenable.
Comprendre l’adaptation transformationnelle : bien plus qu’un simple ajustement
L’adaptation au changement climatique est souvent perçue comme une affaire d’ajustement technique. On renforce les digues, on installe des systèmes d’irrigation plus efficaces, on multiplie les îlots de fraîcheur en ville. Ces mesures sont nécessaires, mais elles reposent souvent sur une logique de continuité avec les systèmes existants.
L’Adaptation transformationnelle, à l’inverse, suppose un changement structurel des modes de vie, des systèmes économiques, des institutions et des pratiques sociales. Elle remet en cause les causes profondes de la vulnérabilité climatique, qu’elles soient sociales (précarité, inégalités), institutionnelles (verrouillages réglementaires) ou écologiques (perte de biodiversité, artificialisation des sols).
Selon le GIEC (AR6), l’adaptation transformationnelle est définie comme celle qui modifie les attributs fondamentaux d’un système socio-écologique. Elle ne se contente pas de protéger l’existant, elle ouvre la voie à de nouvelles trajectoires de développement, compatibles avec les limites planétaires et les objectifs de justice sociale.
Ce type d’adaptation reste encore rare. Il suppose de penser sur le long terme, de prendre des risques politiques et de coordonner des acteurs aux intérêts parfois divergents. Il peut aussi nécessiter de renoncer à certains usages du territoire, à certaines logiques économiques, ou à des modes de gouvernance traditionnels.
C’est pourquoi il est essentiel de disposer d’un cadre clair pour identifier ce qui relève vraiment d’une transformation et ce qui n’en est qu’une illusion. Le travail mené aux Pays-Bas propose justement une méthode robuste pour évaluer le caractère transformateur d’une action d’adaptation, au-delà des intentions affichées.
Un cadre d’évaluation en six dimensions
Face à la complexité du concept d’adaptation transformationnelle, les auteurs de l’étude ont proposé un cadre structurant, fondé sur six dimensions complémentaires. Chacune permet d’évaluer une facette du caractère transformateur d’une action. L’approche ne vise pas à classer les projets entre « bons » et « mauvais », mais à identifier leur niveau de transformation, leurs limites, et les leviers possibles d’évolution.

Utiliser le canva numérique en ligne
1. La profondeur du changement
Cette dimension mesure à quel point une action remet en cause les structures, les objectifs et les valeurs du système concerné.
Trois niveaux sont distingués :
- Superficiel : amélioration technique sans changement d’objectif (ex : meilleur drainage agricole)
- Intermédiaire : adoption de nouvelles pratiques sans transformation du système (ex : cultures tolérantes au sel)
- Profond : remise en cause des priorités et des logiques dominantes (ex : abandon des terres agricoles pour restaurer des zones humides)
2. La portée (scope)
Il s’agit ici d’évaluer la transversalité de l’action : touche-t-elle plusieurs secteurs ? implique-t-elle plusieurs catégories d’acteurs ?
- Faible : une action dans un seul domaine, portée par un acteur isolé
- Moyenne : une action impliquant plusieurs domaines ou plusieurs acteurs
- Élevée : transformation systémique multisectorielle et multi-acteurs
3. L’échelle (scale)
L’action s’inscrit-elle dans un périmètre local, régional ou national ? Plus elle touche de territoires, de populations et d’institutions, plus elle a un potentiel systémique.
4. La vitesse de mise en œuvre
Un changement lent peut manquer son effet si le contexte évolue plus vite. Inversement, un changement rapide mais superficiel ne suffit pas. La vitesse doit être évaluée relativement à l’ambition de l’action : une réforme nationale peut être lente sans perdre sa valeur.
5. La réduction de la vulnérabilité sociale
Ici, on ne mesure pas seulement l’exposition aux risques climatiques, mais la capacité de l’action à réduire les inégalités structurelles. Une action transformationnelle doit aller au-delà de la protection physique pour s’attaquer aux causes sociales de la vulnérabilité (précarité, accès au logement, marginalisation).
6. La réduction de la vulnérabilité écologique
Enfin, une adaptation transformationnelle doit viser la restauration des écosystèmes et non seulement la protection ponctuelle. Cela implique de réduire les pressions structurelles (pollution, artificialisation, fragmentation des habitats), pas seulement de créer des zones tampons ou des corridors verts.
Ces six dimensions sont interdépendantes : un projet peut être rapide et local, mais très profond ; ou inversement national et transversal mais peu ambitieux sur le plan social. C’est dans cette lecture croisée que se révèle le potentiel transformateur d’une action.
Enseignements issus des initiatives françaises : adapter de manière transformative en France
L’analyse réalisée aux Pays‑Bas prend tout son sens lorsqu’on la transpose aux réalités françaises, où se multiplient projets et stratégies d’adaptation, mais souvent sans caractère systémique ni transformationnel.
Exemples d’initiatives structurantes
- Le Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC‑3), publié le 10 mars 2025, structure 52 « mesures » déclinées en 200 actions organiques autour de cinq axes, notamment la résilience des territoires, l’adaptation des secteurs économiques et la mobilisation citoyenne. Bien qu’il marque un point d’évolution par rapport aux versions antérieures (PNACC 1 et 2), certaines critiques soulignent le caractère largement incitatif et le manque de financements contraignants pour porter des actions réellement transformantes.
- Provence‑Alpes‑Côte d’Azur, sujet d’une étude du Joint Research Centre (avril 2024) sur l’innovation transformationnelle: le rapport explore le potentiel de réponses innovantes au changement climatique dans cette région, en tirant parti de ressources scientifiques locales, de la coproduction avec les acteurs publics et d’un design de politiques plus systémique.
- Le projet OASIS à Paris, qui transforme des cours d’école en ilots de fraîcheur urbaine, illustre une approche micro‑climatique prometteuse. Une méthodologie GIS identifie les cours à fort potentiel thermique, puis on remplace des dalles imperméables par des matériaux verts, biosourcés et réfléchissants. L’effet de refroidissement est quantifié et suivi.
- La démarche forestière, via cinq systèmes sociaux‑écologiques forestiers (FSES) en France, a fait l’objet d’une évaluation approfondie. Les chercheurs ont analysé plus de 70 indicateurs liés aux capitaux naturels, sociaux, institutionnels et gouvernance. Le constat : les pratiques actuelles tendent à renforcer le capital ressources sans rééquilibrer les capitaux – limitant ainsi la capacité de transformation du système.
Lecture selon les six dimensions du cadre
Profondeur
- Le PNACC‑3 innove dans la stratégie, mais reste souvent superficiel sur le plan profond : des normes sont révisées, mais les structures socio‑politico‑techniques du système restent peu questionnées.
- Le projet OASIS démontre une profondeur modérée : il transforme l’usage des espaces scolaires, mais sans remise en cause de la typologie urbaine globale.
Portée
- Les actions OASIS sont localisées (échelle municipale), peu multisectorielles, donc de portée faible à moyenne.
- En revanche, le PNACC‑3, lorsqu’il est correctement décliné via les PCAET et documents d’urbanisme, peut atteindre une portée élevée.
Échelle
- OASIS reste un projet hyperlocal ; les FSES couvrent des territoires forestiers diversifiés mais limités.
- Le PNACC‑3 a une échelle nationale, avec obligation d’intégrer la trajectoire +4 °C dans les PCAET, les PLU, les SCoT, etc.
Vitesse
- Le projet OASIS avance vite, avec des installations visibles rapidement.
- Le PNACC‑3 agit à plus long terme : sa mise en œuvre dépend du renouvellement des politiques territoriales et de l’engagement institutionnel, donc plus lente.
Réduction de la vulnérabilité sociale
- Le PNACC‑3 inclut la protection des groupes vulnérables dans son premier axe (protection de la population), mais cette dimension reste éparse dans les dispositifs pratiques.
- OASIS cible potentiellement les écoles dans quartiers défavorisés, mais l’impact social reste peu mesuré.
Réduction de la vulnérabilité écologique
- Le PNACC‑3 vise la protection du patrimoine naturel, la diversification des usages de l’eau, et la résilience des infrastructures écologiques.
- Les initiatives forestières analysées restent trop « vigilantes » plutôt que restauratrices : elles s’appuient sur la gestion technique plutôt que des transformations de paysage.
Principaux enseignements pour la France
- La transformation généralisée reste rare. Les initiatives combinant toutes les dimensions (profondeur, portée, échelle, rapidité, réduction sociale et écologique) sont quasi absentes.
- Tensions fortes observables :
- entre profondeur et vitesse : les géants réglementaires nationaux restent lents ; les projets locaux sont visibles mais peu structurants ;
- entre justice sociale et impact écologique : les politiques sont souvent sectorielles et ne combinent pas équitablement ces deux enjeux.
- Le besoin d’assemblage est clair : articuler dynamiques locales comme le projet OASIS ou démarches territoriales innovantes avec les structures nationales pour combiner ambition et efficacité.
- La gouvernance territoriale est clé : les PCAET émergents (seulement 33 % adoptés à fin 2021 en France métropolitaine) doivent être renforcés pour devenir de véritables vecteurs de transformation intégrée.
Archétypes d’adaptation transformationnelle en France
En transposant le modèle des cinq clusters de l’étude néerlandaise, on peut dégager cinq types d’initiatives en France. Chacun présente une combinaison spécifique de profondeur, portée, échelle, vitesse, impact social et écologique :
1. « Eau et sol comme leviers structurels »

Exemples : restauration des zones humides, réaménagement du trait de côte ou renaturation des cours d’eau.
Profondeur importante grâce à une transformation de l’usage territorial. Projet structurant mais souvent lent, mobilisant plusieurs acteurs (services de l’État, collectivités locales, agences comme l’Office français de la biodiversité via le projet Life ARTISAN).
Écologique fort, social modéré. L’ampleur peut atteindre le niveau régional notamment via les documents d’urbanisme intégrant la trajectoire TRACC.
2. « Communautés territoriales transformantes »

Projets locaux multiacteurs, souvent portés par des collectivités ou réseaux citoyens innovants.
Exemple : Time2adapt (métropole de Lille), transforme les espaces urbains en coproduction citoyenne pour renforcer la résilience au climat.
Portée faible à moyenne, vitesse rapide, profondeur modérée, mais avec dimension sociale marquée grâce à la participation des habitants.
3. « Solutions fondées sur la nature »

Initiatives axées sur des infrastructures naturelles ou végétales : corridors écologiques, zones humides, reforestation urbaine.
Exemples : projet Grand Parc Garonne à Toulouse (5 000 arbres plantés sur l’île du Ramier), zones humides à Mandelieu‑la‑Napoule.
Impact écologique significatif, social variable selon les territoires, en général portée et échelle locales, mais profondeur souvent limitée.
4. « Programmes nationaux sectoriels »

Exemple central : PNACC‑3, lancé en mars 2025 avec 52 mesures et près de 200 actions à décliner dans les PCAET, PLU, SCoT, SRADDET.
Grande échelle nationale, portée multi-acteurs confirmée, vitesse modérée à lente, faiblesse en profondeur systémique et impact social concret sans pilotage contraignant (faible en réduction des inégalités)
5. « Projets isolés mais visibles »

Initiatives ponctuelles sans coordination systémique. Exemples : interventions sur bâtiments publics, rafraîchissement de cours, actions ponctuelles d’îlots de fraîcheur.
Impact immédiat, rapidité élevée, mais portée faible, écologie et justice sociale peu adressées.
Synthèse des correspondances
| Archétype français | Profondeur | Portée/Échelle | Vitesse | Impact social | Impact écologique | Portée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eau et sol comme leviers structurels | Élevée | Régional/national | Lent | Moyen | Élevé | Forte |
| Communautés territoriales transformantes | Modérée | Locale à régionale | Rapide | Élevé | Modéré | Forte |
| Solutions nature urbaines / végétales | Faible à modérée | Locale | Rapide | Moyen à faible | Élevé | Moyenne |
| Programmes nationaux sectoriels (PNACC‑3) | Modérée/faible | National | Lent | Faible | Moyen | Moyenne |
| Projets isolés visibles | Faible | Local | Très rapide | Faible | Faible | Faible |
Ces archétypes illustrent bien les tensions observées en France : profondeur vs rapidité, portée vs impact social, etc. Ils suggèrent l’intérêt d’assembler plusieurs types d’initiatives complémentaires, pour combiner la rapidité et visibilité locale des solutions fondées sur la nature avec l’ambition systémique des programmes nationaux.
Vers une stratégie systémique : recommandations pour les porteurs de projets
L’analyse des initiatives françaises à travers les six dimensions de l’adaptation transformationnelle révèle une dynamique fragmentée. Pourtant, plusieurs leviers peuvent être activés dès maintenant pour renforcer la cohérence, l’ambition et l’impact des projets. Voici cinq recommandations clés pour les porteurs de projets, collectivités, aménageurs, agences et acteurs de la société civile.
1. Ne pas chercher la perfection dans un seul projet, mais viser la complémentarité dans l’écosystème d’actions
Un projet local rapide peut jouer un rôle clé s’il s’inscrit dans une vision plus large. À l’inverse, une stratégie nationale ambitieuse sans déclinaisons concrètes sur le terrain perd sa portée. Il faut raisonner en assemblage stratégique : créer des chaînes d’initiatives où chacun renforce les dimensions que les autres ne peuvent pas porter seuls.
2. Intégrer les six dimensions dès la phase de conception
Dans les appels à projets, les cahiers des charges ou les études préalables, il est essentiel d’analyser les leviers mobilisés dans chaque dimension :
- Quelle profondeur de transformation ?
- Quelles échelles touchées ?
- Quelles vulnérabilités ciblées ?
Un autodiagnostic selon le cadre présenté dans l’étude permettrait de révéler les angles morts et de prioriser les efforts d’ajustement.
3. Renforcer la gouvernance intersectorielle
La plupart des initiatives manquent de portée parce qu’elles restent confinées dans un seul secteur (eau, énergie, santé, urbanisme). Une gouvernance réellement transformationnelle doit croiser les compétences et ouvrir des espaces d’interaction entre services, citoyens, entreprises et territoires. Cela suppose des modes de pilotage souples, apprenants et collaboratifs.
4. Travailler les temporalités
Beaucoup de projets sont trop lents pour être pertinents, ou trop rapides pour être robustes. Il faut mieux ajuster la vitesse au type de changement visé :
- Un changement profond et multisectoriel prendra du temps, mais il doit s’engager dès aujourd’hui.
- Une expérimentation locale peut être rapide si elle nourrit ensuite des apprentissages collectifs.
L’enjeu est de séquencer les étapes sans sacrifier l’ambition.
5. Revaloriser les « petits projets » comme leviers de transformation
Trop souvent, les micro-initiatives sont ignorées car jugées trop ponctuelles ou locales. Pourtant, l’étude néerlandaise montre que certains projets communautaires, même modestes, sont les plus transformateurs car ils touchent les valeurs, les normes, les usages. Plutôt que de les marginaliser, il faut les reconnaître, les documenter et les relier à des politiques publiques structurantes.
La transition juste et résiliente appelle une mutation de nos manières de penser, d’agir et de coopérer. Pour cela, les porteurs de projets doivent devenir des architectes de transformation, capables d’articuler vision systémique et actions concrètes, ancrées dans les territoires.
Pour une adaptation climatique qui transforme vraiment
Adapter nos sociétés au changement climatique ne consiste pas à « tenir bon » face aux crises, mais à changer de cap. L’étude conduite aux Pays-Bas et sa transposition en France nous rappellent que l’adaptation transformationnelle ne se décrète pas : elle se construit, dimension par dimension, dans la durée.
Aucune initiative ne peut, seule, répondre à l’ensemble des exigences de la transformation. Mais en combinant différentes approches – locales et nationales, techniques et sociales, rapides et structurelles – il est possible de bâtir des trajectoires d’adaptation plus cohérentes, plus justes et plus efficaces.
Le cadre en six dimensions présenté dans cette étude constitue une boussole précieuse pour guider l’action publique, orienter les financements, concevoir les politiques et évaluer leur impact réel. Il invite à dépasser les logiques sectorielles et les indicateurs purement techniques pour interroger ce que les projets changent vraiment : des usages, des structures, des valeurs, des rapports au vivant.
À l’heure où les territoires français élaborent ou révisent leurs Plans Climat, où l’urbanisme est sommé d’intégrer les risques climatiques à +4 °C, et où les inégalités sociales et écologiques s’aggravent, cette grille de lecture peut devenir un outil de pilotage stratégique au service de la transition.
Transformer l’adaptation, c’est refuser la résignation. C’est faire le pari que chaque projet, aussi modeste soit-il, peut devenir une brique d’un changement plus grand, si tant est qu’il s’inscrive dans une vision partagée et cohérente. À nous collectivement de créer les conditions pour que ces briques s’assemblent, se renforcent et fassent émerger une société capable de prospérer dans un monde profondément transformé.
Pour aller plus loin
Documents stratégiques et cadres nationaux
- PNACC-3 (Plan National d’Adaptation au Changement Climatique)
- Présentation et critiques :
Le Monde – 25 oct. 2024
Wikipédia – PNACC
- Présentation et critiques :
- TRACC (+4 °C) intégré dans les PCAET, SCoT et PLUi
Exemples de projets en France
- Projet OASIS (Paris)
- Étude sur l’effet thermique :
arXiv – 2024
- Étude sur l’effet thermique :
- Grand Parc Garonne / Île du Ramier (Toulouse)
- Zone humide de Mandelieu-la-Napoule
- Time2Adapt – Métropole de Lille
Études d’évaluation et d’initiative en région
- Provence-Alpes-Côte d’Azur – étude du JRC (Joint Research Centre)
- Forêts et systèmes socio-écologiques (FSES)
Ressources complémentaires et synthèses
- Banque des territoires – blog sur l’adaptation climatique
- ADEME – Lettre Stratégie Climat – juillet 2024
- Haut Conseil pour le Climat – Avis sur le PNACC‑3 (mars 2025)